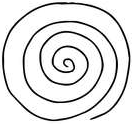Ce spectacle ne vaut rien finalement
Mais par pitié que le feu des pétards
Et les colombes en carton
Nous sauvent d’une morbide apocalypse
Où ces foutres merdre de Père et Mère Ubu
Se prennent à faire le théâtre sérieusement
A. Jarry
Pour son malheur Dominique Collignon-Maurin est une célébrité, pour parler vite c’est une sorte de vedette. Mais pour lui, la piste aux étoiles par tant d’autres convoitée, ne fut jamais qu’une vaste imposture. Il a depuis longtemps pris la fuite. Ses chemins ne sont que brouillages de tout repérages, par nécessité, survie, besoins impérieux de tourner le dos. Il aime plus que tout le théâtre, il aime plus que tout la musique. Les verbiages, les cafouillages, les anecdotes frelatées, l’ignorance merveilleuse des critiques et leur non moins merveilleuse faculté d’inventer n’importe quoi, l’incompréhension parfois totale de son parcours (et même la compréhension), sont la conséquence d’une certaine volonté de la part de Dominique de ne montrer de lui que de fragmentaires miroirs aux alouettes, car on croit tout savoir, car tout aurait été dit sur sa famille, creuset d’une accumulation spectaculaire d’artistes en puissance. Si Dominique cultive depuis toujours la dispersion relative, c’est pour exercer son métier comme lui seul entend le faire. La ruse est là. Du théâtre et de la musique qu’il pratique tous deux intensément dès sa petite enfance, il cherche avec passion la synthèse. En cela, l’esprit jarryesque n’est jamais loin, voire parfois totalement présent. Alfred Jarry donc et la pataphysique dont l’attitude, la tenue, le souffle habitent toutes ses aventures et créations aussi bien musicales que théâtrales. Par goût du jeu, de la farce mirlitonesque, il met en route des trajectoires décalées, tragiques et ridicules. Car il ne s’agit pas de donner dans la déploration, ni même de faire rire, mais juste de prendre acte, en théâtre, de toute joie tout comme du grand désastre. Jarry mais peut-être aussi Witkiewicz pour son goût de la crétinerie pathétique et sans fin, ou alors Meyerhold, car il aimait à forcer le trait plutôt que de se lover dans la tiédeur d’une option naturaliste. Meyerhold ne parlait-il pas du cabotin comme le représentant authentique de l’acteur, nécessitant une implacable technique. Ruptures de registre, acrobaties, répétitions clownesques, faux nez, faux cul, faux seins, prothèses, pour mieux conduire le jeu ailleurs, plus loin, du côté du grotesque et de ses lettres de noblesse… telle une saine colère. Dominique est un ami. Nous avons travaillé souvent ensemble et j’ai pu partager avec d’autres sa connaissance des traditions théâtrales, des plus mineures aux plus grandes, son attrait pour le pantin, marionnette et guignol, enfin sa fascination et sa compréhension de ce qu’on appelle encore aujourd’hui l’Orient. De la pratique du Ney par exemple, rien ne lui est étranger. Mais aussi, tout en écart, ce qui d’ailleurs pour lui va avec, pratiquant un free jazz atonal, évolutif, tout transformation, voire debusyen… Tout vient de là, libres éclectismes, désordres inspirés, gravité et rigueur…
Marie Vayssière