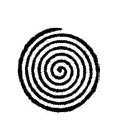Lettre de Bernard Aspe
Il y a d’abord l’espace scénique : un espace en tout point ordinaire, mais comme déconstruit. Les murs ne jointent pas, laissant paraître une salle de spectateurs en miroir, où sont assis les personnages (est-ce le bon terme ?). La porte est au milieu de l’espace, et les entrées et sorties vont se faire principalement à travers un placard (on sent bien qu’il y a une logique de ces franchissements de seuil, une importance particulière des moments où la porte, notamment, retrouve sa fonction de seuil). On peut dire « déconstruction » dans la mesure où ce qui est troublé, c’est le rapport entre le dehors et le dedans, et où ce trouble est indissociablement celui de l’espace théâtral et celui de l’espace familial. L’espace familial, c’est aussi, toujours, l’espace « sacré », l’espace de la sainte famille, et seule LVVI le sait. Elle est « insomniaque », sans doute, parce que les insomniaques savent que ce qui devait être accompli ne l’a pas été – c’est ce qui les empêche de trouver le repos. Elle ne supporte pas l’escroquerie du temps qui passe, du temps qui doit contenir les choses à faire (« … Je dis que maintenant je n’en puis plus de ces trois temps d’agir… »). Mais justement, c’était bien ça, la famille comme utopie : un espace qui est soustrait au passage du temps, un espace où le temps revient. Mais cela n’aurait pas dû vouloir dire : un espace où le temps s’est grippé. « C’est long » dit le fils ; le silence pour les spectateurs ;
mais aussi : vivre, c’est long de vivre. C’est long, une fois que l’accomplissement, c’est sûr, n’aura pas lieu. L’utopie s’est effondrée. Je parle d’utopie en pensant aussi au film de Nicholas Ray, Bigger than life (« Derrière le miroir »), qui me semble être un film sur l’utopie familiale en tant qu’elle s’effondre – et qu’elle est reconquise in extremis. Reconquise une fois que l’on se souvient que, pour que quoi que ce soit s’accomplisse dans l’espace familial, il faut rester tout près les uns des autres (« closer, closer… », dit
James Mason). Mais là encore, cette proximité, c’est aussi le grand danger ; la proximité peut n’être pas la bonne. Ce que figure, dans la pièce, l’exiguïté de l’armoire ; et ce que vérifie la violence sexuelle du père. Car c’est tout de même cela, le comble de la
fin de toute utopie, le retournement de l’image (celle dont le fils ne veut plus, celle qu’il ne veut plus incarner). L’intrusion masculine est de toute façon porteuse de violence (les deux femmes le rappellent souvent ; et Marthe : Qu’est-ce que c’est que cette horreur d’homme, cette saloperie molle qui me recouvre. Qui recouvre le monde qui nique le monde, ses fils et ses filles »). Cela non plus n’aurait pas dû être une fatalité. C’est pourtant un grand problème pour les vivants-parlants, surtout quand ils vivent en famille, et que des nœuds se font dans les flux de désir, dont les objets, par des jeux de substitution, ne se retrouvent plus au bon endroit. L’exiguïté de la maison (de la scène) rend possible cette confusion. Dans la pièce, on arrive alors qu’elle (la confusion) est installée depuis longtemps, depuis toujours dirait-on. Le souvenir d’un temps autre a disparu. Alors pourquoi je parle d’ « utopie » ? Parce que j’ai lu le texte, et vu la pièce, comme ça : avec des « personnages » qui regrettent quelque chose ; qui regrettent ce qu’ils font (monologue du père), sans doute, mais qui regrettent aussi quelque chose qui n’est pas dit, mais qui est indiqué de façon dérisoire, par l’évocation des miracles (vierge immaculée, fils qui monte au ciel). Quelque chose d’autre, dont il ne reste que des images dérisoires, des images qui ont elles mêmes participé à la catastrophe, cette catastrophe qu’est devenue la famille. Et en plus, il y a la société, à laquelle il s’agit tout de même, et malgré tout, de savoir se vendre. Passer un entretien d’embauche pour la pub ; payer les dettes, qui renvoient à l’existence qui échappe, ou à ce qui de l’existence devrait ne plus revenir (« Marthe : « Plus un rond, plus une tune, que d’la dette. Je crois que… je… n’existe plus… Que je n’exerce plus… Il faut que ça n’existe plus! »). Parfois, ils chantent, à un moment même ils chantent ensemble, du moins ils sont tous entraînés par une musique et des paroles folles (« psychopompe… » ; l’influence majeure que je vois, c’est Artaud, et la violence du texte en est digne). Alors il y a quelque chose qu’on pourrait appeler une dysharmonie commune; mais c’est juste avant que soit prononcée par le fils, la sentence : « Famille de merde ! » La violence du texte : si grande qu’elle en est libératrice. Tout ce qui reste encore à dire, il faudra bien trouver les mots
pour le dire. Et le théâtre avec ses effets, sa « magie » ici congédiée. Ce que l’on aurait aimé, c’est qu’il y ait des pétards, de la fumée,
et des lumières, des apparitions et des disparitions. le théâtre est là pour mimer les miracles de la sainte famille. Lorsqu’on l’en prive, alors il reste cette manière bien singulière d’exposer le « rien ne se passe ». On voit alors le théâtre, comme la famille, à nu. Crudité, violence, prison de gestes (le repas quotidien). Et pourtant, encore une fois : ce qui domine, étrangement, c’est (comme avec Artaud, donc) une impression libératrice de décrassage, de décantation.
Bernard Aspe